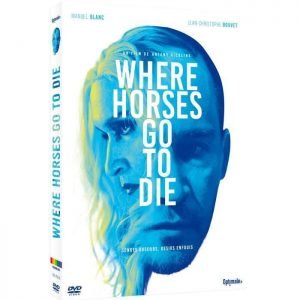Where Horses Go to Die est un film dramatique français réalisé par Antony Hickling, sorti en 2016.
Where Horses Go to Die
Présenté en sélection officielle à l’Étrange Festival (édition 2016), le troisième film d’Antony Hickling est un objet déroutant, dont la narration foisonnante est parcourue de trouées avant-gardistes. S’il impressionne par la fusion qu’il opère entre un cinéma primitif (de par sa proximité avec le théâtre) et un art plus romanesque du récit, Where Horses Go to Die vaut peut-être surtout pour l’acuité documentaire qui s’y manifeste, à travers l’exploration d’un Paris secret, obscur et marginal.
Intérieur, nuit
Where Horses Go to Die commence dans une solennité pesante, qui ne laisse pas augurer du meilleur : la première scène nous plonge dans l’atelier du peintre Daniel (Jean-Christophe Bouvet), dont on suivra le parcours erratique pendant un peu plus d’une heure, tandis qu’une voix-off déclame comme d’outre-tombe un monologue introspectif et hermétique. Bien vite, Hickling substitue cependant à l’emphase pompeuse de l’ouverture, une forme de légèreté mélancolique – presque d’inconsistance – qui donne définitivement au film son rythme de croisière. En mettant trois prostitués esseulés – un travesti, un transsexuel et une femme tout en rondeurs – et leur maquereau sur la route de Daniel, le cinéaste fait bifurquer le portrait de l’artiste en panne d’inspiration vers l’exploration d’un Paris nocturne et confidentiel, presque réduit à une succession de bistrots, de cabarets et de recoins obscurs. Au début, Antony Hickling semble un peu hésiter entre saisie naturaliste des lieux – lorsqu’il orchestre la rencontre entre Daniel et Divine – et loufoquerie surréaliste – quand il se livre à des expérimentations visuelles dignes d’un Kenneth Anger, dans les scènes qui cultivent une forme d’ésotérisme psychédélique. Mais le film trouve dans cette esthétique incertaine une vitalité certaine, qui le rend suffisamment perméable à la réalité de la ville. À ce titre, les errements de la prostituée Divine (Walter Dickerson) dans les rues de Pigalle, sous le feu des néons, sont pour Hickling l’occasion de travailler une lumière à la fois tranchante et éthérée, qui rappelle – à son échelle – la photographie ciselée des films crépusculaires de Michael Mann tournés en numérique (à commencer par Collateral) : plus que son personnage principal, le véritable peintre du film est bien Antony Hickling. Surtout, ces plans nocturnes frappent par leur capacité à fondre acuité documentaire (puisque l’on capte la vie d’un quartier, de ses habitants, de ceux qui le traversent) et bouillonnement fictionnel (les personnages et les acteurs sont au premier plan, dans tous les sens du terme) dans une même effervescence narrative : c’est cet alliage subtil qui confère à Where Horses Go to Die l’exaltation feuilletonesque d’un certain cinéma français, qui courrait des Vampires de Feuillade aux derniers films de Zulawski, en passant par le colossal Out 1 de Jacques Rivette. En effet, Antony Hickling déploie ici une profusion diégétique étourdissante, que l’on croyait définitivement perdue dans les scènes borderline de La Fidélité où Andrzej Zulawski filmait les déambulations de Sophie Marceau et de Guillaume Canet dans un Pigalle endiablé.
Pluies d’artifice
Conjointement au récit de cette rencontre, la quête d’inspiration de Daniel est au fond, pour Antony Hickling, un prétexte au déploiement d’une pléthore d’artifices visuels et sonores. Sans contrarier l’efficacité du récit, ceux-ci l’emportent bien souvent vers des cimes avant-gardistes. Certes, les tentatives du réalisateur sont loin d’être univoquement fécondes – il excède parfois les limites du kitsch, sans l’interroger vraiment d’un point de vue esthétique. Mais force est de constater qu’il parvient, sur la durée, à produire une étrange sidération : à plusieurs reprises, Where Horses Go to Die arbore ce lancinant «montage des attractions» défendu en son temps par Eisenstein, en particulier lorsque Hickling se plaît à aligner les saynètes burlesques, à cultiver un cinéma primitif et forain – dépourvu néanmoins de la forme de naïveté qu’il pouvait par exemple revêtir vers la fin du Cuirassé Potemkine. Ce double héritage apparaît particulièrement saillant dans quelques fulgurances, comme ce bref combat au couteau – qui s’insère ex abrupto dans la narration – entre les comédiens Manuel Blanc et Luc Bruyère, calqué sur le tournoi d’escrime final du Noroît de Jacques Rivette, pareillement tiré vers l’abstraction. Il se manifeste toutefois plus explicitement encore lorsque le film renvoie à une théâtralité brute et exacerbée, telle qu’on pouvait la trouver, non seulement chez Rivette, mais aussi chez Werner Schroeter : les flâneries anxiogènes des quatre prostitués dans l’intriguant manoir, au cours desquelles ils arpentent une topographie intime où s’entrechoquent passé et présent, rappellent certes le montage fantaisiste et primitif de Céline et Julie vont en bateau (dans le rapport des personnages à l’espace de la maison), tourné par le premier, mais peut-être plus encore les ruptures de ton toutes théâtrales de Deux, réalisé par le second.
En dépit de quelques réserves, on peut donc légitimement se réjouir de la sortie de Where Horses Go to Die. Avec une économie de moyens impressionnante, Antony Hickling parvient à articuler le récit balisé d’une quête existentielle à une ambition avant-gardiste : ce mélange détonnant entretient une fascination durable et précieuse.
Critikat
Maël Mubalegh
Distribution
- Manuel Blanc : Manuela / Marco
- Jean-Christophe Bouvet : Daniel
- Amanda Dawson : Candice
- Alexandre Styker : François
- Luc Bruyère : Mohammed
- Esteban François : Thomas
- Walter Dickerson : Divine
- Stéphanie Michelini : une prostituée
- Hervé Joseph Lebrun : Milice
- Anthony Ross : Milice
Fiche technique
- Titre : Where Horses Go to Die
- Réalisation : Antony Hickling
- Scénario : Antony Hickling et Céline Solignac
- Décors : Livia Colombani
- Costumes : Hervé Delachambre
- Musique : Julien Mélique & Simon Leopold , Loki Starfish
- Montage : Victor Toussaint
- Photographie : Yann Gadaud
- Producteur : Antony Hickling et Matthew Allen
- Production : Hickling & Allen Films
- Distribution : Optimale (France)
- Pays d’origine :
 France
France - Durée : 67 minutes
- Genre : Drame
- Dates de sortie :